

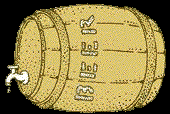 LA BIERE
LA BIERE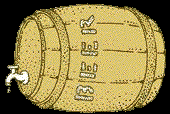
Bière belge à base d'orge et de froment aromatisée d'épices diverses. Son aspect trouble est tout à fait normal. Son goût acidulé en fait une boisson très agréable l'été. Hoegaarden, Blanche de Bruges…
 INTRODUCTION
INTRODUCTION
Autour de nous, aujourd'hui comme hier, nous pouvons souvent entendre cette phrase si souvent répétée et chargée d'histoire et, parfois, de sous-entendus : "Tu viens boire un pot ?". Très souvent ce pot contient de la bière, surtout dans les milieux estudiantins comme le nôtre. Cette boisson posséderait-elle un pouvoir d'accoutumance ? En fait elle est le résultat de traditions millénaires et d'innovations incessantes. On peut effectivement se rendre compte, en étudiant son histoire, à quel point toutes les civilisations ont fabriqué une boisson qui s'en rapprochait. Cette fabrication, comme on peut s'en rendre compte dès que l'on s'y intéresse quel que peu, est une technique elle aussi millénaire et très évoluée. Celle-ci laisse tout de même une grande liberté et donc donne lieu a toutes sortes de bières. Pourtant la majorité des buveurs connaissent peu ou pas du tout le type de ce qu'ils boivent alors que la particularité de la bière est justement sa diversité. De plus de nombreux médecins ont vanté les bienfaits de cette boisson. Enfin on peut remarquer que la bière a développé toutes sortes de traditions et de commerces autour d'elle, comme le sous-bock ou même certaines traditions moins visibles dans les brasseries.
 HISTOIRE DE LA BIERE
HISTOIRE DE LA BIERE
La bière est une des boissons alcoolisées les plus anciennes qui soient. Son origine remonterait, selon les historiens, a l'âge de pierre, à la même époque que le pain, aux origines de la culture de l'orge, c'est-à-dire à l'âge de pierre. Mais les chercheurs ont découvert les premiers documents archéologiques relatant la fabrication de boissons fermentées a base de grains.
A Babylone, 4000 ans avant l'ère chrétienne, des tablettes d'argile révèlent l'existence d'une boisson fermentée appelée Sikaru, celle-ci était portée à ébullition, pour la débarrasser des impuretés bactériologiques, ce qui était important dans ces régions sèches. Des stèles révèlent que cette boisson, servie dans des Maisons de bière tenues par des femmes, se buvait à l'aide de pailles ou de roseaux. Il en existait dix-neuf types, dont l'un, adouci au miel, destiné aux femmes. Elle détenait un important pouvoir économique dans cette civilisation comme mode de paiement en nature des salaires et prestations : le personnel du domaine recevait trois litres de bière, les femmes du harem cinq litres ainsi que les intendants. Le roi Hammourabi (1730-1690 av. J.-C.) fut l'auteur du plus ancien des codes, il réglementa le fabrication et la vente de cette boisson. Cette loi était dure : parce qu'ils trichaient sur la qualité ou la quantité, certains se virent enterres vivants, d'autres furent noyés... dans leur propre bière, dit-on.
C'est en Egypte que commença réellement l'épopée de la bière, où elle devint une boisson nationale consacrée au dieu du soleil Osiris, en même temps qu'un monopole d'Etat. Les brasseurs égyptiens faisaient fermenter, dans du jus de dattes, du pain d'orge émietté auquel il ajoutait ensuite toutes sortes d'ingrédients destines a enrichir et à accentuer le goût : cumin, gingembre, myrte... Celle-ci portait le nom de zythum. D'origine divine, elle bénéficie de la double protection d'Isis, la déesse de l'orge, et d'Osiris, patron des brasseurs. Elle était tout d'abord une boisson d'offrande religieuse liée aux cérémonies funéraires, comme le révèle le Livre des morts : " Je siège sur mon trône... Je reçois les offrandes de mes autels, je bois des cruches de bière à la nuit tombante". De plus, lorsque tout était fini, pour le dernier voyage, le plus pauvre des Egyptiens emmenait avec lui quatre sortes de bières.
Tout le monde y va donc de sa pierre pour améliorer le goût et la qualité de la bière, comme cet empereur romain, Domitien (51-96) interdit la culture des vignes sur les terres où les céréales peuvent pousser. Le paysan arrache le vigne, plante de l'orge... et fabrique de la bière.
Tout le monde connaît la célèbre cervoise de nos ancêtres les Gaulois. L'origine de mot - comme sa musicalité - est très belle : il se compose de " Cérès ", déesse des moissons, et de " vis " qui , en latin, signifie la force. Tout un programme de rêve. La cervoise était une infusion d'orge germée, parfois additionnée d'avoine, de seigle ou de blé. Mais, sans l'apport du houblon, elle n'avait pas le cara ctère amer, donc très désaltérant, de notre bière, d'autant plus qu'elle était bien plus forte en degré d'alcool. La cervoise étant très importante, un dieu lui fut consacre, Sucellus, représenté à côté de la déesse de l'hydromel, une cruche dans une main, un maillet dans l'autre. Pourquoi un maillet? Parce que le gaulois, très inventif, mais encore plus lorsqu'il s'agit de boire, inventât un conditionnement de gros pour la bière : le tonneau. Ainsi , pendant très longtemps le métier de tonnelier sera adjoint a celui de brasseur.
Malgré un rôle prééminent dans le sacré, la bière va connaître des problèmes lors de l'évangélisation, au début de notre ère. La religion chrétienne venue du Sud, progresse vers le Nord de l'Europe, les vignes méditerranéennes gagnent les terres à céréales du Nord. La guerre entre la bière païenne et le vin sacré, le sang du Christ, vient de commencer. Elle est la partie visible de la lutte entre deux religions, deux civilisations. La devise de la communauté des cervoisiers de Paris comportait cette phrase significative : "Bacchus, Ceres aemula" (Cérès rivale de Bacchus). Durant tout le Moyen Age, la bière va être dénoncée par les médecins, prêtres, chroniqueurs, elle sera accusée de tous les méfaits. En 306, un prêtre va jusqu'à menacer les brasseurs d'excommunication! Les proverbes qui raillent la bière et vantent le vin se retrouvent dans toutes les chroniques du Moyen-Age : "Qui boit du vin se régénère. Qui boit de la bière dépérit " La bière se retrouve ainsi associée aux pratiques occultes et aux sabbats. Victime de cette véritable guerre des religions, celle qui fut le breuvage des dieux va devenir la boisson du vaincu. Elle devient la boisson des pauvres, servie dans des cruches de terre, elle n'est pas digne de figurer sur les tables des nobles. Mais ce combat opposait en réalité, d'après certains historiens, le christianisme au protestantisme, et surtout en France, car les moines étrangers jouèrent un grand rôle dans la fabrication de la bière, en y apportant des techniques nouvelles, avec l'aide de certains souverain s comme Wenceslas 1er, roi de Bohème, qui établit la peine de mort pour quiconque exporterait des boutures de houblon de son pays. Peut-être ne s'agissait-il que d'une histoire de gros sous, mais quoi qu'il en soit, ceci nous prouve l'utilisation du houblon dans la fabrication de la bière. Ce même roi obtint du pape Innocent IV la révocation d'un édit interdisant la fabrication de la bière, ce qui n'empêcha pas les chrétiens français de continuer à lutter contre cette boisson. Pendant ce temps, le houblon se répand de plus en plus, entre autres grâce à Jean sans Peur (1371-1419), dijonnais, duc de Bourgogne, qui créa l'ordre du Houblon, dont la mission consistait à répandre l'utilisation de la plante dans tout le pays, son rôle sera déterminant. Autre fait très important, alors que ce termine le Moyen Age, le mot bière apparaît pour la première fois dans un texte officiel.
Nous sommes en 1435. Guillaume IV est Electeur de Bavière lorsqu'il émet la très renommée Reinheitsgebot : la Loi de pureté, visant en fait a pousser le peuple a boire plus de bière, en améliorant la qualité. Celle-ci est toujours en vigueur, et elle a été adoptée par la Norvège et la Suisse. Les Bavarois y sont très attachés, le fait suivant le prouve parfaitement. En 1919, la Bavière, pour entrer dans la République, exigea :
- que l'emploi de l'expression "Etat libre" soit conserve pour désigner la Bavière ;
- qu'une commission bavaroise distincte siège au Vatican ;
- que la Reinheitsgebot soit toujours en vigueur.
Un autre souverain est moins cher au coeur des amateurs, c'est Louis XIV. Il a signé ce qui a failli être l'arrêt de mort de la bière en France. A cette époque, le droit coutumier stipulait que "nul ne pouvait brasser de la bière s'il n'avait passé avec succès son examen de maître brasseur". Louis XIV ayant besoin d'argent, il institua le monopole de la fabrication au plus offrant. La vente de la bière étant d'un bon rapport, les riches spéculateurs se battirent, les prix montèrent, et les brasseurs perdirent leurs brasseries au profit d'ignares en matière de bière. La qualité de la bière baissant, les consommateurs - ayant eux aussi un palais... - se tournèrent vers les quelques maîtres brasseurs qui subsistaient, lesquels regagnèrent le marché, les autres faisant faillite. C'est ainsi que la bière fut sauvée par le goût et le savoir-faire .
Durant le XVIII° et le XIX° siècle, peu de grandes innovations, la bière entre dans l'Encyclopédie et les expositions universelles permettent de découvrir les productions étrangères.
Durant le XIX°, se développent surtout des lieux d'échange et de conversation autour d'une bière, mais pour découvrir cela, il nous faudrait écrire un livre... en attendant, il est facile d'en retrouver l'ambiance dans Balzac.
 LA FABRICATION
LA FABRICATION
"Pour faire une image, je dirai que l'orge est le corps de la bière, l'eau en est le sang, le houblon en est l'âme, et la levure est a l'origine de son esprit. Il existe aussi des définitions plus précises." La définition la plus fréquente est : " boisson obtenue par la fermentation d'un extrait aqueux de céréales germées, additionné de houblon." Celle-ci n'est pas fausse, malgré son manque de précision, ou plutôt , grâce a ce manque de précision.
La fabrication se divise en plusieurs étapes:
- le stockage
- le maltage
- le brassage
- la fermentation
- le conditionnement
Le stockage
L'orge arrive à la brasserie. Il faut la stocker, mais, avant, la sécher. Lorsque l'orge qui est livrée est très humide, il est nécessaire de la sécher artificiellement. Le brasseur utilise parfois la touraill e, mais, de plus en plus, les brasseries sont équipées de séchoirs spéciaux, lesquels sont pour la plupart des tours. L'orge part du haut, où elle est chauffée par des radiateurs, puis elle descend lentement, en z igzag, dans un courant d'air chaud (entre 60 et 70°C), puis, arrivée en bas, elle est soumise à un courant d'air froid. Le périple dure une soixantaine de minutes. Il existe diverses formes de stockage. A l'origine, on faisait appel a u grenier ordinaire, et, comme l 'orge stockée doit être régulièrement aérée, à la pelle. Aujourd'hui encore, le grenier est utilisé, mais son aménagement est particulier. Il a été mis au point un système dit "à ruissellement" : les planchers des greniers sont aérés. Les grains passent d'un niveau à l'autre en étant éparpillés. Arrivés au dernier, ils sont remontés au premier par un systè ;me d'élévateur, et le circuit recommence. Parfois, le grenier ordinaire est transformé en "grenier aéré" par un système de ventilation installé sur le toit.
Toutefois, le système le plus répandu est le stockage en silos. Un silo mesure de 10 à 15 mètres de hauteur. L'aération de l'orge est réalisée par un système de transvasement : les grains tombent sur un convoyeur qui les conduit à une pelle à ruban qui les remonte ensuite en haut des silos. Là, un nouveau convoyeur redistribue les grains dans les silos.
Le maltage
Le maltage est la transformation de l'orge en malt. Il est nécessaire pour : développer dans l'orge les diastases qui transformeront l'amidon en sucres ; rendre le grain friable ; mettre en valeur l'arôme de l'orge. Cela réclame plusieurs opérations dont l'ensemble constitue le maltage, à savoir : nettoyage, trempage, germination, touraillage, dégermage.
Le nettoyage
L'orge stockée contient des poussières, des pierres, des mottes de terre, des clous parfois... Elle arrive directement des champs. Il est donc nécessaire de la nettoyer. Divers appareils séparent l'orge des corps étrangers (tamis, aimant), puis une soufflerie enlève la poussière. Ensuite, le bon grain doit être séparé des grains cassés qui ne germeraient pas, et c'est à nouveau le tamis. Enfin, le grain propre a l'utilisation est convoyé vers de nouveaux silos, où il attendra son heure.
Le trempage
Son but est de donner au grain suffisamment d'humidité et d'oxygène pour la germination. C'est aussi un nettoyage supplémentaire. La méthode est simple : le brasseur trempe les grains dans l'eau, les ressort puis les a&egrav e;re. De quelque 15% d'humidité, le grain d'orge saturé passe à environ 45%.
La germination
Pour que les grains germent correctement, il faut s'assurer que la température, le taux d'humidité et l'aération sont adéquats. La germination permet la libération des diastases indispensables à la désagrégation de l'amidon, à la formation du sucre... A l'origine, la germination se faisait sur de aires. Cette méthodes n'est presque plus employée. Elle demandait beaucoup de main d'œuvre, puisqu'elle consistait à é ;tendre l'orge en couches d'épaisseur déterminée dans d'immenses salles appelées "germoirs". Le degré d'humidité, l'aération et la température étaient définis selon l'épaisseur d e la couche. Aujourd'hui, la germination est pneumatique. Le gaz carbonique est retiré, la température et l'humidification contrôlées, le tout mécaniquement. Citons deux procédés : la germination en cases et la germination en tambours. Les grands principes sont identiques : circulation de l'air et retournage.
Le touraillage
Lorsque tout l'amidon du grain a subi le processus de désagrégation, la germination doit être stoppée. Pour ce faire, on supprime l'humidité du grain en le chauffant. Le grain d'orge devenu malt ne contient plus que 4% d'humidité au maximum! L'opération s'effectue dans une tour appelée touraille (d'où le nom touraillage).
La touraille comprend, dans la partie inférieure, un foyer, et, au-dessus, la chambre de chaleur où l'orge est disposée sur des plateaux. Deux grands types de touraille:
- celle à feu direct - l'orge est chauffée directement par la chaleur produite ;
- celle à calorifères - l'air chaud est conduit dans des tuyaux et n'est pas en contact direct avec le produit.
Deux phases essentielles dans le touraillage :
- la phase de dessiccation (entre vingt-cinq et trente heures) durant laquelle, lentement, la chaleur est élevée. L'humidité s'échappe.
- le coup de feu (environ quatre heures) : 80°C pour les malts pâles et 105°c pour les malts foncés.
En Bavière, au moment de cette opération, certains brasseurs pour certaines bière fument le malt, ce qui donne, bien sûr, une bière légèrement fumée.
Le dégermage
Lorsque le malt est encore chaud, il faut retirer les germes qui ne se seraient pas détachés durant le touraillage. Pour cela il existe une machine simplement appelée dégermeuse. Ensuite, le malt est stocké et ne pourra être utilisé pour le brassage que quinze jours après au minimum.
Le brassage
L'art et le but du brassage est d'extraire du malt, et du houblon qu'on y ajoute, tous les principes actifs, afin de produire un moût de classe. Tout d'abord, le malt est concassé, afin qu'il donne le maximum de son arôme. Puis viens le brassage proprement dit, où la malt est mélangé à de l'eau, selon plusieurs méthodes : la décoction, l'infusion, ou un mélange des deux. Le choix du brasseur dépend du matériel à s a disposition et du type de bière produite.
Le moût obtenu par l'une ou l'autre des méthodes doit être filtré car il contient des substances solides. Le moût est ensuite stérilisé pour bloquer les réactions conséquentes à la germination. Ensuite viens une étape délicate, qui consiste a refroidir le moût. Celle-ci comporte des risques d'infection donc elle est réalisée très rapidement. Ensuite on ajoute la levure qui doit commencer à ; fermenter presque immédiatement. La fermentation joue un rôle très important puisqu'elle consiste à transformer les sucres du moût en alcool. On utilise deux types de levures : hautes, qui flottent à la surface (fermentation haute), et basses, qui coulent au fond du fût (fermentation basse). Celle-ci comporte deux grandes phases :
- la fermentation principale, qui dure de sept à dix jours à environ 8°C pour la fermentation basse et de quatre à six jours, entre 15 et 20°C.
- la fermentation secondaire, où la bière se sature en gaz carbonique, se clarifie, et affine son goût.
La bière obtenue est enfin conditionnée, en bouteilles, en fûts ou en boîtes.
 LES GRANDS TYPES DE BIERES
LES GRANDS TYPES DE BIERES
La classification bière blonde ou bière brune est insuffisante voire arbitraire, mais elle permet à une brasserie de guider sa clientèle ou d'ordonner quelque peu sa carte, encore que le plus fréquent, dans une bonne brasserie, est un classement selon le pays d'origine. Mais ici nous allons effectuer un classement selon la fermentation, puis ensuite, dans ces deux grands groupes, d'une manière arbitraire mais qui se révèle assez satisfaisante pour la compréhension (enfin je le pense).
LA FERMENTATION BASSE
Il existe un vocabulaire assez particulier propre aux bières de fermentation basse. Il est nécessaire pour la compréhension d'une carte de brasserie, nous allons donc retenir ici seulement les termes courants; si vous avez des doutes quand à une bière, n'hésitez pas à questionner le patron, il est la pour cela et sera ravi de vous guider dans votre choix.
BOCK
Appellation d'origine allemande. Les Bocks sont des bières foncées, sombres même. Certains brasseurs en produisent de légèrement plus claires. Ce sont des bières fortes, entre 6 et 7°. Elles se boivent à la chaleur ambiante; légèrement rafraîchies pendant les chaleurs.
Attention : en France et en Belgique, par des détournements incompréhensibles, désigne des bières blondes et légères. Donc contrôler l'origine de la bière est parfois utile.
a)
Le Bock Traditionnel est fait uniquement de malt. Très fort, assez dense, il est peu amer. Sa couleur varie du cuivre profond au brun sombre et on peut parfois ressentir un arrière-goût de fruits, mais restant faible.
b)
Le "Helles" ou Bock Allemand. Le mot allemand signifie "de couleur claire", donc telle est ce Bock. De densité proche du Bock Traditionnel, alors que son amertume est plus marquée, il ne doit pas laisser ressortir de parfum de fruits et se boit légèrement fraîche.
DOPPELBOCK
Bière crée par les moines italiens séjournant en Bavière, le DoppelBock ou Double Bock possède un goût dominé par la douceur du malt. Il est très dense et, comme son nom l'indique, très fort en alcool. Pour avoir la dénomination Double Bock, une bière doit titrer au minimum 8°. Toutes les DoppelBock allemandes ont un nom qui se termine en "ator". Parmi ceux-ci figure la bière la plus forte du monde, d'une belle couleur ambrée, inoubliable,